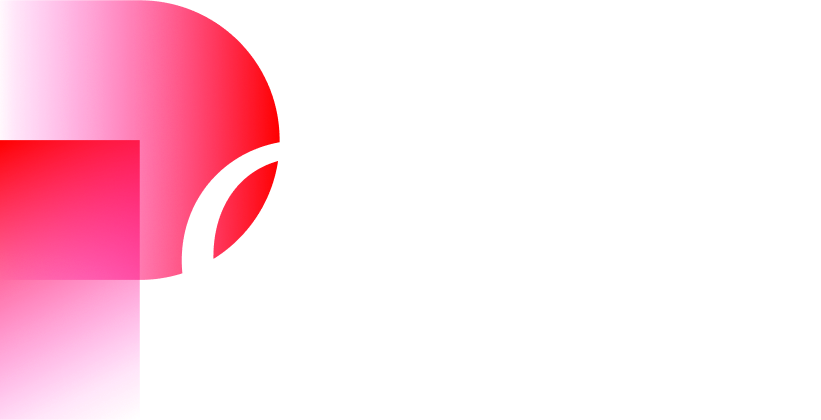Je suis née Blanche Duval, vierge incolore, jeune fille pâle. Mon nom a disparu sous les fards et les poisons. Je suis celle à qui l’on a sacrifié la passion.
J’étais, sous ce nom, la chaste sœur, la giovine sì bella e pura : c’est, du moins, ce que les hommes voulaient faire de moi. Je les revois, mon père, mon frère, à leur retour de Paris, errant dans la maison devenue mausolée, plantant le jardin de marguerites, de violettes et de camélias. Et ces longs repas muets que tous deux noyaient de vin. Je ne comprenais pas. Je préparais mes noces. J’avais été élevée pour ça : préparer mes noces. Me laisser draper de satin et de tulle immaculés. Me laisser conduire, fleur de lys, blanche génisse, à l’autel. Tu as de la chance, me disait-on, ton futur mari est d’excellente famille. Ni vices, ni passions. Une droite ligne, jamais déviée. Et parfois je les voyais, mon père, mon frère, à la fin du repas, alignant des chiffres sur un coin de la nappe blanche tachée de vin. J’entendais les mots « notaire », « dettes », et « dot ». Va te coucher, me disait-on, ce ne sont pas des affaires de femme. Et n’oublie pas tes prières. J’obéissais. Seule dans ma chambre, je priais la Vierge, les anges et tous les saints. Ma mère, aussi, ma mère tôt perdue et dont le prénom de Marie se confondait pour moi avec cette litanie. À tous ceux-là, enfin, j’ajoutais un nom qui, lui, n’évoquait ni image ni parfum, rien d’autre que ces fleurs vite desséchées par le soleil de Provence et que mon frère, sans trêve, replantait : Violetta. Tel est l’ordre que mon père, à son retour de Paris, m’avait donné : mêler chaque soir ce nom à mes prières. C’est, m’avait-il dit, celui d’une mystérieuse amie. Tu lui dois ton bonheur. N’oublie jamais ça. Et ne pose pas de questions. J’obéissais. Ce prénom, il m’avait bien semblé l’entendre murmuré par mon frère dans le jardin, par les commères à la sortie de la messe, le voir flotter dans la maison aux volets fermés, autour des repas noyés de vin. Une marraine, me disais-je, une tante inconnue. Et même, parfois, ma mère revenue. Ma mère veillant sur moi depuis une autre vie. Blanche, vous disais-je, blanche comme l’oie, la giovine sì bella e pura, et bête à pleurer.
Le jour de mes noces est arrivé. On m’a drapée de tulle et de satin. Les yeux mi-clos dans la lumière aveuglante de ce matin de juin, je me laissais faire, tandis que peu à peu se dessinait l’image d’une étrangère, cheveux agencés en une coiffure exquise et compliquée, lèvres rosies par un fard léger, cou orné d’un fin ruban de perles. Mon frère, soudain, est entré dans ma chambre, plus pâle, plus maigre que jamais. Il m’a regardée comme s’il ne me reconnaissait pas, comme s’il me voyait pour la première fois, jamais je n’oublierai ce regard fiévreux, affolé, et m’a tendu une fleur de camélia d’un rouge éclatant : Porte-la à ton corsage, je t’en prie, fais cela pour moi. J’ai, cette fois encore, obéi. La journée s’est passée dans une sorte d’hébétude. La tête me tournait comme si cette fleur, pourtant sans parfum, exhalait un poison. Elle s’ouvrait peu à peu dans la chaleur de juin, découvrant, sous les pétales écarlates, des étamines jaunes, cireuses comme une chair malade. Tous, me semblait-il, ne voyaient que ça, ne parlaient que de ça : cette marque écarlate sur ma robe blanche. Mon mari lui-même, mon jeune mari flegmatique et timide, ne pouvait en détacher ses yeux. Et dans les travées de l’église, à la table du banquet, j’entendais encore, sous les vœux et les chants, ce prénom murmuré : Violetta. L’heure est venue de la nuit de noces, à laquelle nulle mère, nulle tante, nulle mystérieuse amie ne m’avait préparée. Non plus qu’à ceci : mon mari, mon jeune mari à la fade blondeur, changé en bête furieuse, déchirant mon corsage, masquant mon visage de ses mains, et hurlant dans un spasme ce prénom qui n’est pas le mien.
J’ai vite appris. Chaque nuit, la même cérémonie : mon mari, mon fade mari, posant un camélia entre mes seins, un drap sur mon visage, et à travers moi possédant Violetta. Elle est morte sous ce drap, l’oie blanche, la giovine sì bella e pura. Mais à sa place, nuit après nuit, une autre est née. Et cette autre a appris. À désobéir. À poser des questions. À oublier ses prières. À se refuser. Moi qui ai toujours joui d’une insolente santé, j’ai prétexté, soir après soir, faiblesses et vertiges pour condamner ma chambre. Mais je ne manquais pas de paraître aux repas avec, entre les seins, une fleur de camélia. Mon mari a fini par céder : Si tu veux savoir qui est Violetta, adresse-toi à ton frère. J’ai trouvé mieux : un dimanche, dans la maison de mon père, j’ai quitté la table du déjeuner en feignant un malaise. Les hommes, oies blanches, m’ont crue enceinte, je l’ai senti à leur regard inquiet, attendri, dégradant. Je suis allée droit à la chambre de mon frère. Les rideaux étaient tirés, le lit défait, l’air lourd d’une odeur d’éther et de pétales macérés. J’ai ouvert les fenêtres et là, dans la grande lumière d’août, j’ai vu, sur le secrétaire, le portrait d’une femme d’une étonnante beauté : cheveux de jais coiffés en bandeaux, yeux noirs voilés de grands cils, lèvres entr’ouvertes sur des dents blanches comme du lait et, dans le regard, une expression mêlée d’ardeur et de grâce enfantine. Dans un tiroir que je n’ai pas eu à forcer, des lettres : ces lettres que, tous, vous connaissez, et que j’ai découvertes incrédule, ces lettres où se lisait l’histoire dont dérive la mienne et que d’autres ont écrite pour moi sans jamais me la conter.
C’est ainsi, puisque vous me le demandez, que j’ai percé le secret de Violetta. Et avec lui celui des maisons aux volets fermés, des chuchotements obstinés, des linceuls de tulle et de satin – avec lui, la conspiration des pères, des frères et des maris.
Vous savez désormais le secret de ma vengeance. Car vengée, je le serai bientôt. De Violetta, ou pour Violetta, je l’ignore. Je ne distingue plus bien entre elle et moi. Entre la morte adulée, le cadavre dont mon frère -mon frère effrayant, fou, et froid- a demandé la translation de cimetière en cimetière, et mon corps, si plein, et blanc, et velouté, mais dont tous, bientôt, découvriront incrédules l’éclatante maladie. Une autre forme de translation, si vous voulez. Et qui, alliance ou rivalité, nous unit, Violetta et moi, dans la terre indistincte des filles sans nom.
Méthodique, j’ai d’abord pris pour amant le notaire de mon père, ce vieil homme au teint crayeux, au regard oblique, à la voix assourdie par une vie entière de secrets chuchotés. Il m’a suffi d’aller le voir éplorée, de lui dire que je soupçonnais mon mari de mener une double vie, voulais protéger de ses dévoiements l’enfant que je portais, pour qu’il m’offre conseils et consolation. J’ai vite appris de lui certains détails que les lettres ne m’avaient pas révélés. Et avec eux les gestes et les techniques, les caprices et les docilités auxquels plus tard se mesurerait mon métier. Tu es prodigieusement douée, soupirait le notaire, rêveur. Ses largesses ne suffisaient plus à mes projets -mes grands, mes belliqueux projets. Je l’ai convaincu de me présenter à ses amis : notables de province, nobles pères, frères dévoués, maris aimants, la terne clientèle des débuts de carrière. Tous connaissaient mon histoire- cette histoire que d’autres ont écrite pour moi sans jamais me la conter. Ils possédaient en moi la courtisane et la giovine sì bella e pura, l’oie blanche et la brune Violetta, la victime et l’idole. Ils profanaient à travers moi l’autel de leur respectabilité, les règles et les rites où s’alimentaient leur désir et leur hypocrisie. Comme ils étaient prompts, ceux-là qui avaient sacrifié Violetta, ceux-là qui, prétendant sacrifier Violetta à mon bonheur, nous avaient toutes deux écrasées, elle sous la charge de leur opprobre, moi sous celle de leur honneur, comme ils étaient prompts à me plier à leurs sombres fantaisies. À me couvrir d’argent et de bijoux, aussi. J’étais prête pour la grande scène, le grand jeu : j’avais de quoi m’installer à Paris. Mon mari, dans l’intervalle, avait appris à obéir et à ne pas poser de questions : j’en avais assez entendu, au creux du lit des notables, sur les voies tortueuses à travers lesquelles s’étaient édifiés la fortune et l’honneur de sa famille pour qu’il paie mon silence de ma liberté. Il m’a juste fait promettre de ne pas salir son nom.
Je ne demandais que ça : en finir pour de bon avec Blanche, née Duval et bien mariée. Ainsi est née celle que vous connaissez sous le nom de Rose Du Bois. Vous en avez vite su les fastes et les éclats, c’est ce nom qui bruissait dans vos fêtes, vos soirées à l’Opéra, sous vos masques de carnaval, ce nom qui rassasiait votre appétit de scandale, et que les hommes éperdus criaient à l’oreille des jeunes épousées. Rose Du Bois, couronnée reine de nuit à l’égal de Violetta, Rose Du Bois, au corsage orné de cattleyas, et dont la blondeur, la chair flamboyante, ont fini par éclipser son maigre fantôme brun. J’avais tout, j’avais presque gagné. Seule me séparait encore de la victoire mon insolente santé. Avec moi, ni fièvres ni langueurs, pas de toux déchirante ni de mal intérieur, rien de tout cela qui (avouaient ses anciens amants) prêtait aux étreintes de Violetta un incomparable goût d’agonie. J’avais beau pratiquer des amours multiples, sans protection et haut tarifées, je demeurais indemne, intacte, ennuyeusement saine : Blanche Duval toujours vivante en moi.
Voilà qui, désormais, est réglé. L’heure est venue de ma pleine vengeance. Comme il était beau, celui par qui elle s’accomplit, ce jeune provincial issu en droite ligne d’une famille respectable, fils et frère dévoué, dont les traits lisses, la peau douce, ne trahissaient rien des débauches non plus que de la maladie. Mon éclat se ternit, je perds formes et couleurs, mais porte, invisible, un trésor : une haute charge virale qu’à pleins bras je prodigue, transmets sans compter à vos pères, frères, et maris. Un peu de patience, encore : bientôt, seul subsistera de moi ce souvenir dévorant.
Je ne veux sur ma tombe ni roses ni cattleyas : rien d’autre qu’un roncier.