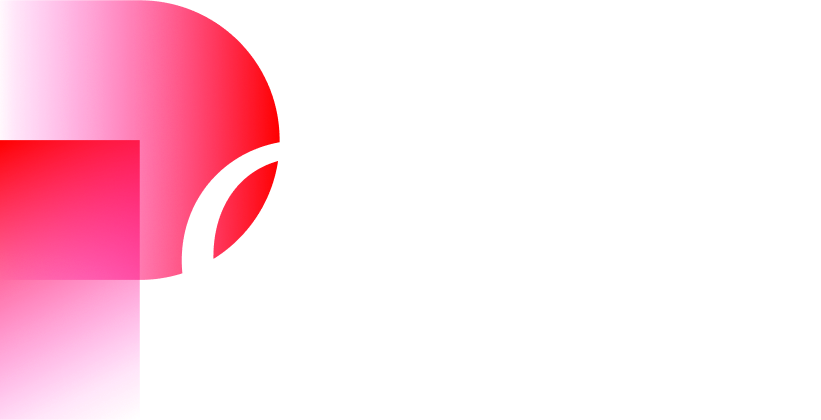Cette révélation m’a été faite un soir, à Bruxelles, dans un club de jazz. J’avais l’habitude d’y aller chaque vendredi après ma semaine de travail à l’École des Arts Visuels de La Cambre. J’aimais y venir en sortant de mon cours, vers dix-neuf heures, bien avant le début du concert, afin de me détendre en buvant l’un de ces whiskies pur malt qui font la réputation de ce club, et profiter de la beauté de ce lieu qui avait la forme reposante d’un écrin — un écrin de velours nocturne (bordeaux, vert bouteille) — un écrin sphérique dont la rondeur moelleuse faisait penser à un petit théâtre à l’italienne, avec son balcon à l’étage où j’avais ma table, et d’où je ne me lassais pas de contempler les deux mystérieux piliers verts en acier chromé plantés au milieu du club.
Lazlo et Bettina n’allaient pas tarder, ils arrivaient en général vers vingt heures, et nous commandions aussitôt nos cocktails favoris : Chien Enragé pour Lazlo, Femme Fatale pour Bettina, et pour moi un Georges Simenon (vodka-pamplemousse-goût fumé).
Ils enseignaient eux aussi à La Cambre : Bettina était architecte, Lazlo plasticien, et nous aimions, chaque vendredi, faire le point sur nos cours, sur les attentes de nos étudiants, sur l’exigence qui nous poussait à chercher de nouvelles manières de transmettre notre passion.
J’avais justement commencé en septembre un cours un peu spécial, disons même hétérodoxe, qui s’intitulait « Histoire des livres oubliés du XXe siècle » ; je défendais l’idée selon laquelle les livres célèbres ne forment qu’un écran derrière lequel d’autres livres, réputés mineurs, participent en réalité à la véritable histoire de la littérature, qui relève selon moi du secret. Ces livres ne subissaient pas l’oubli, ils l’avaient programmé : ils se l’étaient incorporé afin de bénéficier de cette dimension du secret dans lequel une œuvre véritable continue à mûrir après avoir été écrite. Je postulais que chacun de ces livres avait soigneusement dissimulé une révélation à travers ses phrases ; et c’était l’existence même de cette révélation qui faisait que ces livres étaient de la littérature, et même de la grande littérature : sans secret, disais-je à mes étudiants, pas de littérature — sans révélation, pas de livre.
Ainsi avais-je déjà consacré plusieurs heures à étudier avec eux Je brûle Paris de Bruno Jasienski, Le Capitaine au long cours de Roberto Bazlen, Encyclopédie des morts de Danilo Kis, Livres des pirates de Michel Robic, Petersbourg d’Andreï Biely ; et aujourd’hui même j’avais commencé à leur parler des Boutiques de cannelle de Bruno Schulz.
Une petite hérésie littéraire s’était ainsi constituée, qui avait d’abord surpris mes étudiants, plus habitués aux grands noms qu’à celui des outsiders, mais qui semblait leur plaire : ce que j’espérais, à terme, c’étaient qu’ils adhèrent à cette conspiration, que chacun d’eux participe à cette contre-histoire, et qu’en un sens ils fassent partie du secret.
J’étais impatient d’en parler à Lazlo et Bettina : le livre de Bruno Schulz se prêtait parfaitement à ce genre de spéculations dont ils raffolaient tout comme moi. L’écrivain polonais y élaborait en effet — à travers la figure de son père qui jouait le rôle d’un prophète d’Israël — une théorie nouvelle de la Genèse : la création du monde se répétait dans une petite ville de Pologne, en famille, selon des lois exubérantes qui, renvoyant à la Bible, la pervertissaient.
J’aime les théories ; j’aime chercher dans les livres ce qui, dit-on, n’y est pas (mais qu’y a-t-il d’autre dans les livres que des correspondances, des allusions, des signes ?) ; j’aime penser que les livres se parlent à travers le temps — qu’ils se réécrivent les uns les autres : ainsi de Schulz qui réécrit Kafka, lequel réécrit Kierkegaard, lequel ne cesse, comme Kafka et Schulz, de réécrire la Bible, et plus particulièrement le sacrifice d’Isaac par son père Abraham.
Ainsi, dans ce livre soi-disant mineur — Les Boutiques de cannelle —, derrière les vitrines de la rue des Crocodiles, s’accomplissait, j’en étais sûr, ce que Kafka, vingt ans plus tôt, avait appelé de ses vœux une « nouvelle kabbale », c’est-à-dire une écriture sacrée, capable à la fois de manifester la structure cachée du monde et de rallumer le feu de la parole.
J’imaginais déjà avec plaisir la surprise de Lazlo et de Bettina, mais aussi leurs réticences : ils ne se laisseraient pas faire si facilement, la soirée promettait d’être joyeuse.
Je rêvassais, sourire aux lèvres, face aux deux gros piliers verts : il n’était pas possible qu’ils fussent érigés en plein milieu de la salle par une maladresse architecturale : ils étaient si imposants qu’ils obéissaient forcément à un plan ; et voici qu’à la faveur d’un miroitement (car le premier étage du club est tapissé de miroirs où viennent s’iriser les reflets du rez-de-chaussée), ces deux piliers s’étaient déformés jusqu’à vriller sur eux-mêmes comme les colonnes torses que le Bernin a sculptées pour le baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Je m’apprêtais à commander un deuxième cocktail au serveur qui s’avançait vers ma table, lorsque celui-ci, au lieu de prendre mon verre, s’assit dans le fauteuil-club qui me faisait face.
— Pourquoi étudiez-vous Bruno Schulz ? me demanda-t-il.
Je n’eus pas le temps de répondre :
— Depuis la Création du monde jusqu’au ghetto de Varsovie, poursuivit-il, l’emplacement des trous n’a cessé d’être communiqué par le rite, les sacrifices, la prière ; et avec la Shoah, la transmission des trous s’est brisée.
— Quels trous ? demandai-je.
Il ne releva pas ma question. Je distinguais mal les traits de son visage : il s’était assis à contre-jour, et avec l’éclairage tamisé du club, toute sa personne demeurait dans l’ombre, mais les deux piliers, en encadrant sa silhouette, semblaient l’auréoler ; il me vint même à l’esprit, d’une manière un peu loufoque, que sa présence émanait de l’espace entre les piliers.
— La Shoah n’a pas interrompu le processus, continua-t-il : c’est le processus qui a en quelque sorte profité de la Shoah pour s’enrayer. C’est pourquoi il est maintenant nécessaire que la parole continue à frayer à travers des « voies parallèles du temps », comme les nomme Bruno Schulz. La parole passe par les trous, et ces trous sont désormais communiqués par la littérature, par la poésie, par les romans. Avez-vous lu Tree of codes de Jonathan Safran Foer ?
Là encore, je n’eus pas le temps de répondre : le jeune homme continuait son monologue sans se préoccuper de moi.
Jonathan Safran Foer a compris qu’il faut lire les livres en ouvrant la fenêtre qu’ils contiennent. Cette fenêtre est proportionnée au secret que le livre transporte avec lui, c’est-à-dire à la mémoire qui trame ses phrases. Jusqu’où parvenez-vous à voir lorsque vous lisez ?
Je voulus répondre, mais il semblait parler sans me voir.
— Un vrai livre crée une brèche dans le langage : il troue le temps, il traverse les siècles jusqu’à devenir le contemporain des gestes de Dieu ; dans un vrai livre, quel que soit ce qui y est raconté, on assiste à l’engendrement de la lumière, du ciel et des océans. C’est pourquoi Jonathan Safran Foer a découpé au ciseau des phrases dans Les Boutiques de cannelle : en trouant le livre, il retrouve la fenêtre qui donne sur la Genèse.
Je m’aperçus qu'un livre était posé sur la petite table entre nous, juste à côté de mon verre.
— Les phrases de Bruno Schulz donnent sur les premiers temps comme un hublot donne sur la mer. Vous savez que Noé a percé une fenêtre dans l’Arche : c’était pour lâcher la colombe ; pour voir la Terre surgir des eaux. Eh bien, cette fenêtre est toujours ouverte : elle perce les esprits, elle creuse un tunnel à travers les livres — elle fait communiquer les siècles les uns avec les autres. Si vous vous penchez sur une phrase et regardez à l’intérieur de chaque mot, vous verrez le temps qui se traverse lui-même depuis le commencement du monde.
J'ai été pris soudain d'une joie folle et me suis mis à rire, d'un rire illuminé par l'évidence. Cette fenêtre, il me semblait n'avoir jamais connu qu'elle : j'avais passé ma vie à regarder à l'intérieur de chaque mot ; et ce que j'y voyais — ce que je distinguais à travers les livres de Bruno Schulz, mais aussi de Danilo Kis, de Roberto Bazlen, d'Andreï Biély, c'était ce bleuté aventureux de la lumière qui donne sur l'Arche.
Le serveur me tendit mon deuxième Georges Simenon, sur lequel je me jetai en observant les deux piliers dont la couleur verte étincelait dans les ors du club : ils ressemblaient maintenant aux deux colonnes du Temple de Jérusalem.
J'ai avalé d'un coup sec ma vodka-pamplemousse. Je continuais à sourire. Le trou de lumière entre les deux piliers m'éblouissait ; et à la place du jeune homme dont la silhouette s'était effacée aussi vite qu'elle était apparue, il y avait ce livre à l'apparence si fragile que je n'osais avancer la main vers lui.
C'était un étrange volume : il faisait penser au corps d'un oiseau. Je l'ai soulevé avec délicatesse, il ne pesait rien. J'ai pensé : un livre en plumes, un livre plein d'air — un livre ailé.
C'était Tree of Codes : le livre de Bruno Schulz découpé par Jonathan Safran Foer.
En ouvrant le volume, j'ai vu les trous. J'ai vu les fenêtres. On n'avait gardé que quelques mots à chaque page, et ils semblaient flotter comme des mobiles sur un fond de page blanche.
Ça me faisait penser au Coup de dés de Mallarmé, ce poème qui lance ses mots dans le ciel pour y fonder une constellation. Mais ici, chaque mot donnait sur un autre mot, et un récit se formait instantanément au hasard des pages, un récit qui profitait du vertige ouvert par les trous ; et alors que j'avais commencé à déchiffrer consciencieusement la trame offerte par ce livre-dentelle, essayant, avec les seuls mots du texte que Safran Foer avait gardés, de reconstituer un récit primitif, d'un coup, au lieu de lire des phrases, je me suis mis à lire le vide. À voir entre les phrases, à évoluer entre les pages, à passer à travers les fenêtres.
Et là, est-ce l'excès de Georges Simenon, est-ce la fatigue de la fin de semaine, est-ce la lumière ensorcelante qui venait du Temple de Jérusalem, spécialement diffusée pour moi entre les deux piliers verts du club, je me suis mis à voir, comme l'étrange jeune homme me l'avait annoncé.
En tournant les pages de
Tree
of Codes, j'ai vu un désert, un couteau, une gorge ouverte à l'éclair du
couteau, et la main de celui qui retient le couteau. J'ai vu du sable et des
pierres, des sources apparaître avec ce bleuté de l'Arche, et des montagnes
couvertes d'oliviers, et les premières herbes mouillées par l'océan, des
biches, des girafes, des panthères endormies. J'ai vu, en m'approchant, le
pelage brûlant des panthères, les paupières des girafes, puis le fin duvet qui
recouvre les cuisses d'Ève. J'ai vu des chevaux s'ébrouer dans des prairies, et
des ruisseaux s'ouvrir entre les forêts. J'ai vu du sang séché sur le mur des
grottes. Puis du feu sur les visages, du sang, des algues, des rires. Tout
s'est mis à danser, les pelages, le couteau, les cuisses, les rivières, et la
lumière m'a transporté pour toujours.
Yannick Haenel