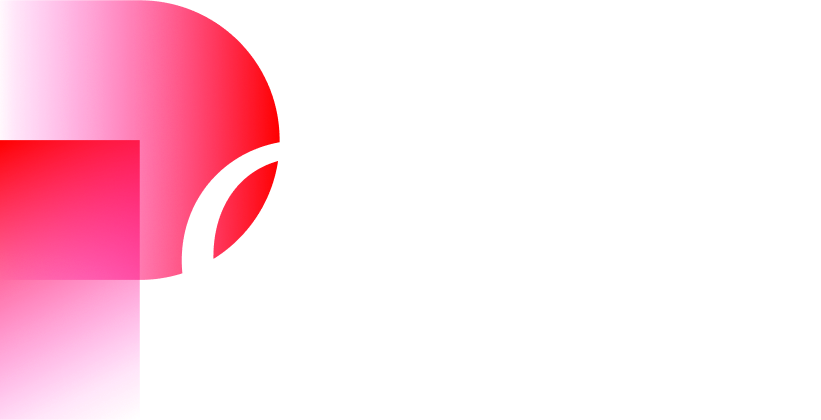Où allez-vous, comme ça ? Oui, vous ! Le menton noble, les bras métronomes, le souffle arrogant, le regard lointain. Vous faites presque peur à voir. Il ne manquerait plus que vos pas résonnent et on aurait franchement la trouille. Mais vos pas ne résonnent pas. Vous marchez en silence, vos foulées amorties, assourdies dans l’air ouaté. Vous êtes des animaux de conte, des animaux qui n’existent pas, des animaux royaux. Une bande. Vous êtes une bande. Votre allure est sautée, basculée, dissymétrique. Pose du postérieur gauche, pose du bipède diagonal gauche, pose de l’antérieur droit. Et projection. Et projection. Et projection. Au galop, au galop ! Vous paradez. Un son, et vos visages à l’unisson se tournent dans la même direction. Un mouvement, et vos corps font corps ensemble. Dans un bruissement, vous faites le même geste. Vous allez où, comme ça ? Ensemble, comme une armée, comme un assaut. Vous avez l’air si décidés, si sûrs, si fiers. À vous regarder, on pourrait croire que vous vous rendez à une fête. Vous allez sans détour, sans hésitation. Le dos droit, l’envie qui vous poursuit, le désir qui vous rattrape. Vous êtes terriens.
Vous marchez pour vaincre. Vous êtes des animaux vaniteux.
Moi, je ne marche pas droit. Je me cogne à tout ce qui croise ma route. Le sol tangue, le ciel tangue, même la lumière tangue. Hier, demain, je ne sais plus où je me trouve. Est-ce le matin que je vois poindre dans le ciel, ou bien est-ce le soir qui décline ? La clarté aussi vacille. Et moi, je titube. Des jours entiers, je titube. Le chagrin guide mes pas, le chagrin et puis les regrets, le chagrin et puis les regrets et l’alcool, les chagrins et puis les regrets et l’alcool et le chagrin que donnent les regrets et l’alcool. J’ai l’esprit brumeux. La ville file tout autour de moi qui chancelle. Je ne marche plus droit, à quoi bon ? Je marche en zigzag, j’entreprends des volte-face d’ivrogne.
Malgré tout, je continue. Il n’y a que ça à faire pour rester vivant.
Je
marche.
Quand vous marchez, vous partez ou bien vous revenez ?
Mais vous allez où, comme ça ? Avec toute cette naïveté que vous portez sur vous comme une veste de costume. La tête claire, les idées dégagées. Vous ne savez pas ce qui vous attend, vous avancez sans savoir ce qui va se passer. Vos corps disent que vous êtes pourtant certains, francs, presque catégoriques. Vous avez le mouvement intelligible et même une forme de grâce limpide. On vous regarde passer et vous semblez ne pas nous voir. Quand vous expirez, si on regarde avec attention, on voit vos poitrines se soulever. C’est qu’il y a du soupir, là-dessous, sous vos vestes taillées dans votre simplicité. Il suffirait de vous dénuder un peu pour ralentir le pas, regarder les plaintes s’élever et monter jusqu’aux nuages. Mais ça va, vous êtes un groupe. Vous êtes ensemble. Vous vous protégez. Peut-être même que vous allez vous mettre à courir.
Vous marchez pour ne pas pleurer. Vous êtes des innocents qui fuguent.
Moi, je ne sais pratiquement plus marcher. L’âge m’en empêche. Il me faut une canne, une troisième jambe en bois qui me suit comme une ombre. Je vais de travers. Je ne me déhanche plus, je ne cours plus, je claudique, j’oscille. Ils me dépassent tous. Ils ne me regardent pas. Ils marchent sans me regarder, ils me dépassent, ils me bousculent. Je bringuebale mon corps qui ne sait plus être corps. Avec mes trois jambes, nous nous arrêtons souvent, pour reprendre notre souffle.
Malgré tout, je continue. Il n’y a que ça à faire pour rester vivant. Je marche.
Je marche.
Quand vous marchez, est-ce pour rester vertical ?
Vous courez où, si vite ? Vous allez comme des fous, vous tournoyez, vous sautez, vous brisez les lignes, les diagonales, vous allez en tout sens, vous pensez sans doute que ça va durer toute la vie comme ça, que la musique ne s’arrêtera jamais, qu’elle durera jusqu’à ce que la lumière s’éteigne, jusqu’à ce que les mains soient trop abimées pour la jouer, vous pensez sans doute que demain n’existe pas, court, court, long, court court long, court court long. Pourquoi vous courez comme ça ? Vers où vous allez ? Vous avez l’air si gais, si jeunes, même les vieux ont l’air jeunes ; en réalité vous n’avez pas d’âge. Vous êtes une troupe, vous êtes ensemble. Et vous courez. Vous allez comme des fous. Vous tournoyez. Vous voltigez.
Vous marchez pour faire un désordre. Vous êtes des fanfarons chaotiques.
Moi, je marche comme je peux. Courir, danser, je ne l’ai jamais fait. J’ai les yeux clos. Je ne vois jamais la ligne d’horizon. Je marche comme on balbutie, comme on bégaie, comme on tâtonne. J’imagine ma marche, j’imagine mes pieds qui avancent l’un après l’autre sans jamais se toucher, j’imagine mes jambes qui se plient et se déplient et c’est comme si je pouvais les voir. À l’aveuglette, l’aveugle ! Aux oubliettes, l’oubli ! Je me souviens de tout. Je ne peux pas voir mais je peux me souvenir. Ma mémoire, c’est ma danse à moi. J’avance dans le noir. La musique m’aveugle. Alors je flotte, je marche comme je peux, je tergiverse pour traverser, je doute pour tout.
Malgré tout, je continue. Il n’y a que ça à faire pour rester vivant.
Je marche.
Quand vous marchez, est-ce que vous vous retournez ?
Vous venez d’où, tous les trois ? Vous êtes les mêmes et vous êtes différents. Vous marchez comme pour aller au cimetière, l’air grave et les mains dans les poches. Vous portez du noir mais vous êtes un peu nonchalants, vous portez du noir comme ça, pour voir. Vous marchez sur un rythme qui ne vous ressemble pas. Vous marchez à contretemps. Vous êtes comme le printemps, comme le premier soleil qui vient faire éclore les bourgeons sur les branches encore frileuses et sombres et sales de la neige qui a coagulé. Vous avez ce pouvoir. Vous êtes un chœur. Vous répétez ce que vous dites. Vous pensez que vous avez raison. Et que vous ne dites que des choses importantes. Mais il vous arrive de vous couper la parole. Vous venez d’où, vous allez où ? Vous avez une cadence bien à vous. Vous êtes résolus. Au cimetière, vous poserez des fleurs là et là, vous entamerez à nouveau un dialogue malicieux.
Vous marchez pour entendre l’écho. Vous êtes des montagnes mélancoliques.
Moi, je marche courbée en deux. Deux, nous sommes deux dans mon corps, encore pour quelques instants. Je dialogue intérieurement avec l’enfant à venir, je lui dis que c’est possible, que c’est le moment, que ça pourrait être maintenant. Qu’il pourrait venir au monde. J’ai tellement mal que je ne peux plus faire que ça, marcher le long d’un cercle que je me figure, marcher en rond, tourner en rond, avec mon ventre plus rond encore. Je le porte ou il me porte, je ne sais plus. Je marche en m’imaginant danser, je marche en m’imaginant sa figure. Je marche en pensant à l’écho dans les montagnes, aux voix qui parfois se répondent. Je marche courbée en deux, inondée de douleur.
Malgré tout, je continue. Il n’y a que ça à faire pour rester vivant.
Je marche.
Quand vous marchez, savez-vous que vous pourriez tomber ?
Vous allez où, comme ça ? Avec sur vos visages cet air élégant. Vous semblez solides, harmonieux. Vous êtes exubérants, pleins d’une joie vivace et volubile. Quand vous sautez, vous semblez toucher le ciel. Vous sautez si haut. Ensemble, vous êtes ensemble. Élan. Ensemble. Impulsion. Ensemble. Suspension. Ensemble. Réception. Ensemble. Vous avez l’air de chérir ce bouillonnement dans lequel vous évoluez. Vos jambes se lèvent, vos bras s’étirent. Ensemble. Deux ici, trois là. D’autres là-bas. Mais ensemble. Vous êtes un peuple.
Vous marchez pour calmer vos ardeurs. Vous êtes des oiseaux tumultueux.
Moi, je marche chaque jour coincée dans cet espace exigu qu’ils appellent cellule. Une fois par semaine, je peux marcher dans la cour de la prison. J’ai envie de lever les jambes, d’étirer les bras. De sauter, de toucher le ciel, de passer par-dessus les murs épais qui nous étranglent. Mais je marche gentiment, derrière les autres, comme il se doit. J’imagine le saut de ma vie, le saut qui m’enverrait sur le trottoir derrière la muraille, dans la vie qui grouille et dont j’entends seulement les murmures. Le saut de ma vie, élan, impulsion, suspension, réception. Je me répète ces quatre mots comme une formule magique. J’envisage de me les faire tatouer quand je sortirai d’ici. Élan, épaule gauche. Impulsion, épaule droite. Suspension, mollet gauche. Réception, mollet droit. En attendant, je marche dans ma petite cellule, cinq pas dans un sens, cinq pas dans l’autre, je touche le mur, je me retourne, je marche sur mes pas, cinq pas, encore cinq pas, je touche le mur, cinq pas.
Malgré tout, je continue. Il n’y a que ça à faire pour rester vivant.
Je marche.
Quand vous marchez, est-ce pour aller de l’avant ?
Où allez-vous, comme ça ? Avec vos costumes sombres, vos mines mi-figue mi-raisin. Vous vous affrontez, est-ce pour rire ? Un duel d’opérette, un combat pour de faux. Vous vous affrontez tout en marchant et jamais vous n’arrêtez de marcher. Vous marchez sur une ligne droite. Vous vous affrontez. Est-ce pour mieux vous aimer ? Est-ce pour vous mieux vous aider ? À quoi vous mesurez-vous quand vous avancez comme ça, ensemble ? Contre quoi luttez-vous ? Est-ce que vous avez peur ? Et où allez-vous, comme ça ? Avec vos costumes sombres, vos sourires rentrés. Vous défiez le ciel, vous risquez vos vies. En joue ! Sur la ligne droite, vous êtes une foule, mais vous attendez l’ordre divin. Vous le provoquez. Vous voulez le Jugement dernier, maintenant, tout de suite. Presque tout de suite. Vous êtes une nuée. Vous marchez, avec vos costumes sombres. Le Jugement dernier, après la bagarre. En joue, feu !
Vous marchez pour communier. Vous êtes des grammaires solitaires.
Moi, je marche vers l’absolu, vers l’éternité. Quand je marche, je lui parle. Je supplie, je demande, j’implore, je sollicite. J’invoque. Je l’appelle. Je pleure. Quand je marche, je prie. Je lui ai donné mon corps. Je marche pour lui. Le long d’une ligne que vous ne pouvez pas voir, c’est ma promenade, c’est ma prière. Je marche vers l’absolu. Je lève la tête vers le ciel, les yeux fermés, je le cherche des yeux, j’élève mon souffle, je lui murmure des litanies connues de moi seul. Je marche parce que je suis debout. Je suis entre le sol et lui. Il passe en moi comme le tonnerre transperce le béton. Il est mon seigneur, il est mon destin. Je sais qu’avoir un corps est un miracle, je sais que je lui dois ce miracle. Pourtant, j’ai souvent envie d’arriver plus vite près de lui. De n’être plus qu’un esprit aux côtés de lui divin.
Malgré tout, je continue. Il n’y a que ça à faire pour rester vivant.
Je marche.
Quand vous marchez, est-ce pour capturer l’infini ?