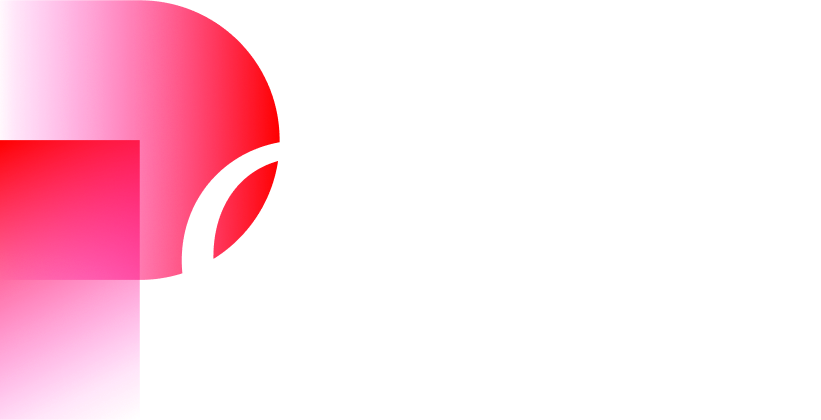Comment revisiter l’un des opéras les plus joués au monde ? En le projetant dans le futur. La Bohème de Puccini – qui jouera à l’Opéra de Paris du 12 septembre au 14 octobre prochains – invoque les amours perdues de Mimi et Rodolfo dans une onirique épopée spatiale. On en a discuté avec les metteurs en scène Claus Guth et Sébastien Guèze, qui a monté et joué dans une Bohème tout aussi futuriste, diffusée sur France Télévisions.
En 2025, qu’est-il devenu de la bohème ? Ce mouvement a longtemps été associé à une jeunesse candidate à la pratique des arts, vivant chichement d’amour et d’eau fraîche sous les toits de Paris. « La bohème n’a rien et vit de tout ce qu’elle a », écrit Balzac dans sa nouvelle Un prince de la bohème . Ses jeunes praticiens font alors déjà l’objet de pastiches. Si au XXIe siècle, elle continue à être régulièrement représentée au cinéma et à la télévision pour transcrire un Paris romanesque, dans les faits, elle traduit aujourd’hui davantage une réalité bourgeoise. Cette obsession dans nos imaginaires culturels à propos de la bohème est un héritage du chef d’œuvre de Puccini, créé en 1896.
Le compositeur italien aspire alors à immortaliser ses jeunes années auprès d’artistes désargentés et révoltés et trouve un écho parfait dans les Scènes de la vie de bohème d’Henry Mürger qui raconte les amours contrariées du poète Rodolphe et de la cousette Mimi. Ces amants sans le sou préfèrent, comme leurs amis Marcello et Musette, se réchauffer en fréquentant les fêtes, le cabaret et en s’aimant. L’issue ? Évidemment tragique. Après s’être séparés un temps, nos deux héros se retrouvent. Elle expire, choisissant l’amour à la sécurité d’un riche protecteur.
Les images véhiculées par le livret de la Bohème correspondent « à quelque chose qui n’existe plus depuis longtemps, à un Disneyland culturel ».
Claus Guth, metteur en scène
L’œuvre rencontre un succès quasi immédiat et devient l’un des plus grands tubes de l’histoire de l’opéra. Tous les ans, La Bohème continue d’attirer des millions de spectateurs dans les salles. En 2023, elle a été jouée à 782 reprises dans le monde , soit une moyenne de plus de deux fois par jour. Difficile à priori de renouveler le genre. C’est pourtant ce qu’ont entrepris le ténor et metteur en scène Sébastien Guèze ainsi que le metteur en scène Claus Guth.
Vers l’espace et le souvenir
« Lorsqu’on m’a proposé de monter la Bohème, j’ai un peu traîné des pieds », se souvient-il amusé. « J’aime profondément la musique de Puccini, mais l’histoire est un tissu de clichés ». Pour Claus Guth, il ne s’agit pas d’artistes désargentés, circonscrits à dépérir dans leur grenier et à ne jamais connaître la gloire. Les images véhiculées par le livret de la Bohème correspondent « à quelque chose qui n’existe plus depuis longtemps , à un Disneyland culturel ».
La Bohème (saison 25/26) © Monika Rittershaus/OnP
Les yeux fermés, le metteur en scène écoute encore et encore l’opéra. « Au début, c’était une blague, mais j’ai dit à Stéphane Lissner – directeur de l’Opéra de Paris à l’époque, ndlr – qu’il sonnait plutôt comme si on flottait l’espace . Si vous ne vous préoccupez pas du texte, [l’œuvre de Puccini] évoque plutôt le pouvoir de l’amour et de l’imagination ». Claus Guth se plonge alors dans une lecture du roman d’origine, Les scènes de la vie de bohème d’Henry Mürger. « En fait, il s’agit surtout d’hommes qui se souviennent de leur jeunesse. Ils idéalisent le passé et leurs souvenirs », poursuit-il.
De là, il imagine déplacer l’action « dans un monde où Paris n’existe probablement plus, ravagé par une guerre atomique ou une crise climatique ». Dans la mise en scène de Claus Guth, Rodolfo et Marcello vivent leurs dernières heures dans un vaisseau spatial en dérive. Les personnages se perdent régulièrement dans la contemplation d’une planète lointaine, la Terre. « Jour 126. Perdu le cap. Dernières réserves épuisées. Mimi revenue », peut-on lire dans le journal de bord tenu par le cosmonaute Rodolfo, projeté au-dessus de la scène.
Mourir du manque d’eau fraîche en 2050
Dans sa version, La Bohème 2050 France TV , Sébastien Guèze propulse nos protagonistes dans les allées du Château de Versailles, devenu un refuge contre le réchauffement climatique. « Les jeunes qui autrefois, mouraient de froid sous les toits de Paris périssent désormais de chaud », explique le ténor et metteur en scène qui rappelle aussi avec son interprétation le caractère profondément universel des enjeux abordés par les livrets d’opéra : « Ils racontent l’amour, les inégalités sociales, la quête de liberté, la jeunesse ».
Et cette universalité rime aussi avec avant-garde, souligne-t-il : « La Traviata (adaptée de La Dame aux Camélias de Dumas fils, ndlr) invoque au XIXe siècle un sujet peu ou pas du tout traité, la prostitution tandis que Carmen met en scène une femme farouchement libre ». Le parti-pris de Sébastien Guèze ne déroge pas à cette tradition futuriste, imaginant une Bohème qui interroge brillamment les effets de la crise environnementale et les dérives du technosolutionnisme. L’un des personnages prend même la forme d’une intelligence artificielle.
« Lorsque vous n’avez pas suffisamment d’oxygène pour respirer, le cerveau commence à délirer »
Claus Guth, metteur en scène
Ce faisant, il pousse l’exercice plus loin en faisant le pari de monter un opéra décarboné (à 80%) . « L’idée de cette œuvre est de présenter un futur désirable et cela passait par cette expérimentation ». Pour changer les imaginaires, il faut les expérimenter, les ancrer dans la réalité : « La sobriété, travailler avec des ressources limitées, se conjugue aussi avec une liberté de création, je crois. Mozart vivait après tout dans un monde décarboné et ça ne l’a pas empêché de composer des œuvres sublimes qui ont traversé les siècles ». Et effectivement, ce pari écologique ne dépare pas la beauté d’un opéra-film aux accents certes apocalyptiques mais furieusement optimistes.
Pas de deux et pas de côté
Si La Bohème de Sébastien Guèze ancre son intrigue dans les élans de la jeunesse, celle de Claus Guth explore l’autre versant de la vie. « Tout ce qui reste à Rodolfo et Marcel, explique-t-il, ce sont leurs souvenirs ». Dans un décor en noir et blanc et pastel, leurs amantes Mimi et Musetta apparaissent en couleurs vives. « Lorsque vous n’avez pas suffisamment d’oxygène pour respirer, le cerveau commence à délirer ». Pour le metteur en scène, lorsque Mimi apparaît dans le premier acte, « c’est un souvenir de Rodolfo ». En grand fan des films qui se déroulent dans l’espace, Claus Guth rend hommage à ces scènes où l’être aimé apparaît devant le cosmonaute, à l’instar de Solaris de Tarkovski (1972). 2001, l’odyssée de l’espace compris – et du cinéma tout court, en associant en vrac un strip-tease à la Gilda , un dragon doré… et la sortie extravéhiculaire d’un cosmonaute. Le rideau du IIIe acte se lève sur un cratère de lune. Çà et là, des débris de navette. Les réacteurs sont enfoncés dans le sable lunaire tandis que sous la neige, les cosmonautes évoluent péniblement. Sublime.
La Bohème (saison 25/26) © Monika Rittershaus/OnP
Au-delà de créer des images d’une beauté littéralement intersidérale, le pas de côté dramaturgique de Claus Guth, qui fixe l’action dans l’espace, permet aussi d’interroger un futur aux ressources restreintes. Lorsqu’ils chantent un vin délicieux, la réalité montre les protagonistes se repaître de maigres gouttes d’eau. Les mets, ils doivent les partager. « C’était déjà dans le texte d’origine. Quand ils parlent de champagne, il s’agit en fait d’une piquette. Il fallait simplement le porter plus loin ».
Dans un monde qui va à vau-l’eau, qu’est-ce qui devient précieux, interrogeait déjà l’œuvre de Puccini. « Les arts, l’amour, la gloire ? Qu’est-ce qui est important quand tout s’effondre ? », abonde Claus Guth. « Je suggère, le spectateur dispose ». Et c’est là toute la saveur des revisites de nos tubes culturels. Nous faire rêver, nous interloquer, nous bousculer, nous faire réfléchir et aussi peut-être en embuscade, nous émouvoir…