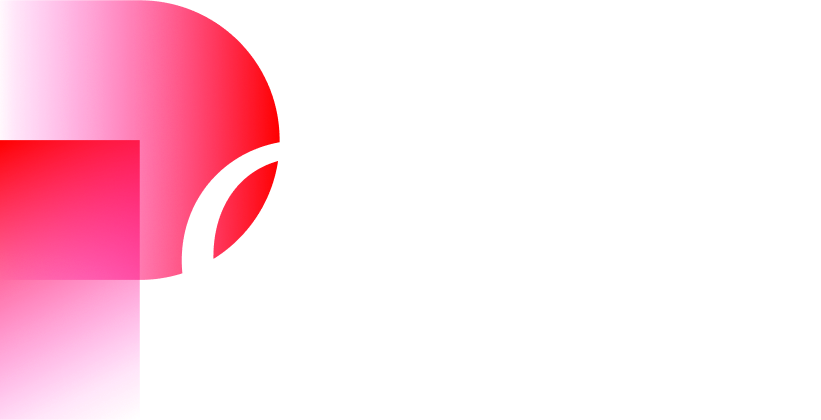L’opéra, un art total ? À l’occasion de la nouvelle production de Boris Godounov à l’Opéra Bastille, dans une mise en scène d’Ivo van Hove, et pour savoir si cette définition, héritée du romantisme allemand, est toujours d’actualité, Alexandre Lacroix - écrivain, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine - est allé à la rencontre de tous les métiers et sensibilités qui contribuent à la création d’un spectacle d’opéra – dramaturge, metteur en scène, chef d’orchestre, scénographe, vidéaste, chanteurs, musiciens, costumiers, éclairagistes… En partenariat avec Philosophie Magazine.
Neuvième rencontre
Sous la grande verrière, galerie des balcons de l’Opéra Bastille, le 1er juin
Ivo van Hove a demandé à être rejoint sur le « plateau ». C’est-à-dire sur la scène de l’Opéra, nue. L’escalier sur lequel monteront les chanteurs et le chœur a été recouvert de tissus protecteurs. Des machinistes enroulent des câbles ou rangent des caissons noirs à roulettes. Ivo est seul au milieu de l’espace, tournant le dos à la salle vide, éteinte. Il porte un jean, une chemise bleu pétrole ainsi que les baskets que je lui ai vues sur toutes ses photographies récentes. Méditer, sur une scène immense : celui qui détient le pouvoir n’a d’autre choix que la solitude. Il doit s’absenter en son for intérieur pour trancher. À qui ferait-il confiance, sinon à lui-même ? Le pouvoir est une cime où l’on ne se tient pas à deux. Telle est la situation de Boris. Mais aussi celle d’Ivo, metteur en scène, à quelques jours de la première.
Nous quittons le plateau, sortons du côté des balcons et allons nous asseoir dans la galerie extérieure, sous la grande verrière. Dehors, le soleil de fin d’après-midi, rasant, noie la circulation de la place sous ses rayons ; le métal des voitures éblouit. Dans deux heures, Ivo assistera à la pré-générale, ce sera la première fois qu’il verra son opéra entier. Ce sexagénaire a beau avoir dirigé cent cinquante spectacles au cours de son existence, la tension est palpable. La conversation doit aller vite, comme une mécanique parfaite elle aussi.
Aviez-vous un rendez-vous avec Boris Godounov en 2018 ?
Ivo van Hove : C’est Stéphane Lissner [le directeur de l’Opéra national de Paris] qui m’a demandé, il y a trois ou quatre ans, si monter Boris Godounov m’intéressait. Je lui ai répondu par l’affirmative, mais avec une condition : je voulais mettre en scène la première version, celle de 1869. Aujourd’hui, la version la plus jouée est celle de 1872, qui est plus longue et très différente. J’ai ensuite échangé avec Vladimir Jurowski, qui se joignait à cette aventure. Ce n’est pas un choix évident pour un chef d’orchestre, car la deuxième version est peut-être plus intéressante sur le plan musical. Mais la première version est bien plus passionnante sur le plan dramatique.
Elle est plus politique. Il n’y a aucune digression, le drame est concentré autour de la figure du tsar. Boris Godounov et le peuple sont les deux personnages principaux.
Il y a six mois, j’ai rencontré votre dramaturge, Jan Vandenhouwe. Il a tracé un parallèle étonnant entre Grigori, l’aventurier qui se fait passer pour l’héritier légitime du trône de Russie, et Donald Trump. Le succès de Grigori auprès du peuple repose sur un mensonge, une fake news : il a usurpé l’identité du jeune prince Dmitri assassiné ! Dans votre mise en scène, Grigori représente-t-il un leader populiste ?
Non, non, Grigori n’est pas un populiste mais un carriériste. Il a été manipulé par le moine Pimène, qui lui a donné envie de cette épopée, de cette marche sur le Kremlin. Je considère Pimène comme un idéologue, une sorte de Steven Bannon. Il est très conservateur. Il estime que la solution pour la Russie serait de retourner dans le passé, un rêve réactionnaire qui fleurit un peu partout dans le monde actuel. Grigori n’est que son soldat. C’est un opportuniste dépourvu d’idéologie. Un autre personnage m’intéresse, le prince Chouïski.
Oui, l’un des grands de l’empire. Il appartient à l’élite, mais il y a en lui une forte composante stratégique. La suite de l’Histoire nous enseigne qu’après la mort de Boris, son fils Fiodor montera sur le trône pendant quelques mois, après quoi Grigori deviendra tsar un an, enfin Chouïski récupérera le pouvoir. Cela a du sens à mes yeux : Chouïski voit plus loin.
Jan suggérait que Boris Godounov, qui s’efforce de bien gérer le pays, de faire des réformes éclairées, sans gagner vraiment le soutien populaire, ressemble à un technocrate, et qu’on peut voir en lui une sorte d’Emmanuel Macron. Qu’en pensez-vous ?
Lorsqu’on transpose un opéra dans le monde contemporain, on cherche bien sûr à construire des passerelles avec l’actualité. Mais il ne faut pas être trop schématique. Ce qui nous a saisi, Jan et moi, après l’élection présidentielle de 2017 en France, c’est la conscience qu’avait Emmanuel Macron de vivre un moment historique. La manière dont il a organisé sa lente, très lente arrivée dans la grande cour du Louvre, ou dont il a composé sa photographie officielle, témoigne d’un sens profond de la mise en scène. Le parallèle avec la cérémonie du couronnement qui occupe le premier tableau de Boris Godounov est tentant. Mais la comparaison s’arrête là.
Du côté de chez Brecht
Depuis le mois de décembre dernier, j’ai déjà rencontré une dizaine de personnes impliquées dans la production de ce spectacle, du côté des ateliers décor, des costumes… Or, il m’a semblé que le dispositif conçu par Ivo van Hove se conformait assez précisément aux recommandations données par Bertolt Brecht, dans sa « préface » à Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (1930).
Aux yeux de Brecht, l’enjeu d’un opéra est de présenter sur scène les rapports de domination tels qu’ils existent dans la société, afin de permettre au public de les contempler de l’extérieur et de les comprendre. Brecht souhaitait que le décor soit dépouillé à l’extrême afin que le spectateur conserve son indépendance critique, qu’il ne soit pas envoûté par l’action – Ivo a choisi de présenter aux spectateurs un plateau presque désert, avec seulement un escalier et un écran géant. Brecht était contre les costumes d’époque – et les chanteurs du chœur devront ici ressembler aux passagers d’un RER. Brecht estimait que la musique devait communiquer le texte, mais ne pas chercher à l’imposer ni à le rehausser – et Vladimir Jurowski m’a expliqué son intention que la musique soit le subconscient du spectacle.
Brecht a-t-il été une source d’inspiration importante pour ce travail ?
Chaque metteur en scène utilise un jour ou l’autre des choses que Brecht a inventées. Pourtant, je n’aime pas trop son propre théâtre et n’ai jamais mis en scène aucune de ses œuvres. Je préfère considérer Boris Godounov comme un prolongement des grandes tragédies politiques de Shakespeare, une source d’inspiration permanente pour moi. Brecht est trop didactique. Il veut dénoncer la lutte des classes et préparer l’avènement du communisme. Il aurait probablement choisi la seconde version de « Boris », qui aboutit à une révolution. Dans la première version, l’élite reste en place et le peuple est frustré. Lors du final, on a l’impression que le peuple est réduit à la passivité et plutôt indifférent. Il me semble que c’est ce qui se produit de nos jours. Je ne crois pas à une révolution imminente.
De l’art véritable du manager
On ne compte plus les traités de « management » à destination des dirigeants d’entreprise. Pourtant, le mot anglais de management vient de plus loin : de l’italien maneggiare, qui veut dire « manier » et qui lui-même est dérivé de manus, « la main » en latin. Diriger une pièce de théâtre, un opéra, n’est-ce pas faire un métier qui touche à l’essence même du management ? Comment porter chacun au maximum de son talent et de ses possibilités expressives, sinon en pratiquant un « maniement des âmes » d’une extrême finesse ?
J’imagine qu’on peut pousser les gens, chanteurs, musiciens, techniciens, à donner le meilleur d’eux-mêmes par plusieurs moyens, la persuasion, l’autorité, la maïeutique… Comment qualifieriez-vous votre pratique ?
D’abord, je me prépare très bien. Je ne commence pas mon travail de mise en scène avant d’avoir une connaissance approfondie de la partition. Dans un opéra, le livret ne joue pas un rôle fondamental, je dirais que cela représente 20% de l’œuvre. J’ai besoin de savoir quelles sont les informations importantes, sur le plan musical, derrière chaque portée de notes.
Oui, mais c’est encore intellectuel, cela n’explique pas comment vous traitez avec les artistes.
Disons que je considère chaque chanteur comme un individu.
Silence.
On m’interroge souvent là-dessus, mais il n’y a pas d’autre méthode valable. J’observe, j’écoute et trouve ma manière de m’adresser à chaque chanteur. Je traite chacun comme un être humain à part. Avec X, je découvre qu’il va falloir discuter énormément. Tandis qu’avec Z, mieux vaut se contenter de dire : « Tu dois entrer par là et sortir par là. » Il s’agit d’une sorte d’art de la psychologie.
Comment les discussions se déroulent-elles face à un chef comme Vladimir Jurowski ?
Ecoutez, j’ai travaillé avec David Bowie. Et je m’y prenais avec lui comme avec n’importe quel collaborateur. Il n’a jamais utilisé son statut ni son pouvoir. Je l’ai convaincu de modifier la fin de son spectacle Lazarus. J’avais des raisons profondes. Il les a écoutées, puis il a dit : « Cela me semble bien, il faut le faire. » À un certain niveau, les gens n’ont plus rien à prouver. Les intimidateurs, les « bullies » [petits chefs, NDLR] sont toujours des médiocres. Vladimir m’a aidé et je l’ai aidé, c’est une collaboration. Par exemple, hier, je lui ai demandé à propos d’un effet scénique : « J’ai besoin de toi, j’ai besoin que la musique soutienne cet effet scénique. Sur quelle note doit-il se produire selon toi, celle-ci ou celle-là ? » Voilà, c’est une conversation.
Le secret est de mettre entre parenthèses les questions d’ego afin d’échanger uniquement sur l’objet artistique…
Les êtres humains sont néanmoins fragiles. Certains tombent malades, d’autres ont le trac ou traversent des crises personnelles. Comment allez-vous faire pour que tout le monde soit au maximum de ses capacités le soir de la première ?
C’est le secret de ma cuisine ! Mais ce que je réussis, je le dois toujours à une équipe, des compagnons de route avec lesquels je travaille depuis longtemps : il y a Jan Versweyveld pour la scénographie et les lumières, Tal Yarden pour les vidéos, An d’Huys pour les costumes, Jan Vandenhouwe pour la dramaturgie. D’autre part, avec tout le monde, je crois qu’il faut être sincère. Les gens sentent si on est faux ou vrai avec eux. Durant les répétitions, j’observe et je communique mes émotions. Quand j’ai un doute, je le dis sans détour.
Adorno au combat de gladiateurs
Tout en travaillant à ce Journal de Boris Godounov, je n’ai jamais pu me défaire d’une réflexion sur le théâtre que j’ai trouvée chez Theodor W. Adorno, dans son article sur L’Opéra bourgeois (1955) : « Il serait juste d’interpréter l’opéra comme la forme spécifiquement bourgeoise qui, paradoxalement, cherche à préserver l’élément magique de l’art au sein d’un monde désenchanté en usant des moyens de ce monde même. »
La phrase est dense, abstraite, mais elle me semble aller au cœur d’un paradoxe de l’opéra : il s’agit certainement d’un art destiné à une élite sociale, à la bourgeoisie, qui suppose des moyens colossaux, donc des subventions privées ou publiques, et pourtant, au sein d’un tel dispositif qui ne saurait résister à une critique de type marxiste, l’enjeu est de préserver un élément magique, c’est-à-dire de faire surgir quelque chose comme la beauté ou la vérité.
Je lis la phrase à Ivo pour recueillir son point de vue.
« Il serait juste d’interpréter l’opéra comme la forme spécifiquement bourgeoise qui, paradoxalement, cherche à préserver l’élément magique de l’art au sein d’un monde désenchanté. » Est-il d’accord ?
I. van H. : Je n’aime pas trop cette phrase. Je trouve ça vieux. Parler ainsi, avec ce vocabulaire, c’est vraiment XXe siècle. Le football est-il bourgeois ? Non. Pourtant, le dispositif coûte des millions et rien n’est aussi cher qu’une place pour un match du Mondial. Un concert de rock ou de reggae sont-ils bourgeois, sous prétexte qu’ils sont chers ? Vous voyez, approcher ces réalités en termes de classes sociales est trop réducteur.
Mais Adorno dit aussi autre chose : l’opéra s’est imposé comme un art majeur, voire comme l’« art total », au XIXe
siècle, du temps de Verdi, de Wagner, de Moussorgski, donc précisément à
l’heure d’une apothéose de la société bourgeoise, et il a gardé les
stigmates de cette origine. C’est encore aujourd’hui la bourgeoisie qui
va majoritairement à l’opéra, et ce n’est pas seulement une question de
prix, mais de formation sociale du goût.
Tout ne s’est pas figé, il y a chaque année des créations d’opéras nouveaux ! Au XXe siècle, il y a eu les opéras d’Alban Berg, d’Igor Stravinsky, de Leoš Janáček. Et aujourd’hui, Thomas Adès est un compositeur de très haut niveau, pour ne donner qu’un exemple. Je pense que la phrase d’Adorno reflète surtout ses propres préjugés.
Dans le cas présent, la question est tout de même inévitable : Boris Godounov est un opéra qui traite exclusivement des rapports entre le peuple et l’élite. Peter Sellars disait qu’à l’opéra, si vous aviez quelque chose à dire aux grands de ce monde, ils étaient assis aux premiers rangs ! Est-il possible de montrer et de critiquer les rapports de domination dans un lieu fréquenté par l’élite et appartenant à l’Etat ? Ou bien cette critique n’est-elle qu’un leurre, car elle est neutralisée d’avance par le dispositif ?
Ce n’est pas ma manière de réfléchir sur les choses. Comme metteur en scène, mais aussi comme spectateur à l’opéra ou au théâtre, je déteste qu’on me dicte une manière de penser. J’aime la dialectique. On m’a demandé, dans une interview, si j’étais d’accord avec la manière de gouverner de Boris Godounov. Or, quand je montre une scène avec Boris, je suis totalement Boris. Quand je fais une scène avec Chouïski, je suis totalement Chouïski. Je m’identifie aux personnages, je ne les juge pas. Je me considère comme un metteur en scène subversif et non comme un moraliste.
Approfondissons cette notion de « subversion ». Qu’est-ce qu’être « subversif » en mettant en scène un opéra en 2018 ?
Pourquoi, selon vous, des millions de personnes se déplacent chaque année en Espagne pour aller voir Guernica de Picasso ? Contempler cette toile est une expérience très intense. Elle représente un massacre. Il n’y a aucun espoir dans ce paysage de guerre. Pourquoi va-t-on voir Médée au théâtre, alors qu’on sait qu’elle va tuer ses enfants ? Les grandes œuvres d’art sont subversives parce qu’elles explorent le négatif et c’est à leur subversion qu’elles doivent leur pouvoir de fascination. (Ivo se retourne et montre la place de la Bastille, toujours scintillante dehors, à travers la baie vitrée.)
Dans la vie, j’aime que les êtres humains s’arrêtent au feu rouge. Qu’ils respectent les lois. J’apprécie de vivre dans une société ordonnée. Mais ici, dans ce bâtiment, cet opéra, nous travaillons sur les situations chaotiques. Le chaos et la cruauté sont en nous, ils sont indissociables de la nature humaine. Mais il vaut mieux commettre un meurtre sur une scène que dans la rue. La subversion du théâtre ou de l’opéra consiste à représenter ces sentiments de cruauté, ces instincts de destruction. Pour les évacuer, pour nous en délivrer.
Une telle démarche a-t-elle sa source dans la tragédie grecque ou dans le combat de gladiateurs ?
Pour moi, c’est exactement la même chose !