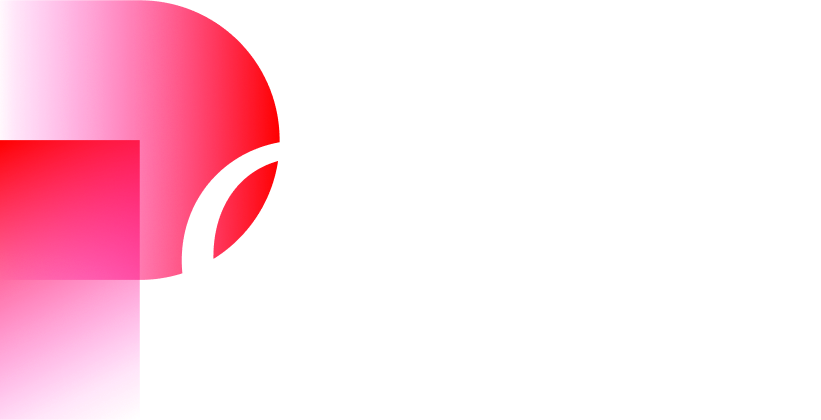Je suis un vieil homme, maintenant, qui a connu beaucoup de choses, beaucoup. Il est une chose, cependant, que je n’ai pas connue ; le temps est venu de la vivre. Et tout est prêt. C’est pour ce soir.
Il fait un peu moins chaud qu’hier mais l’humidité demeure dans cette nuit presque faite sur la forêt équatoriale. Depuis la terrasse de la villa — ce palais dont les colonnes rappellent un temple —, j’aperçois le lit mauve de la mer en contrebas, loin, là-bas, très loin après les derniers contreforts de la montagne, bien au-delà des frangipaniers serrés contre la côte. C’est quelque part entre la pointe d’Orabazza et le Capo Rosso que ça va se passer, que la barrette illuminée du paquebot (on disait « transatlantique » quand j’étais jeune) glissera sur les vagues, lourde et lente, et cela ne durera qu’un instant, une seconde d’éternité, mon éternité, ma joie de vieil homme, mon dernier projet.
Oui, tout est prêt. Entre la mer et moi se dressent l’amphithéâtre — cirque enchanteur —, ses ruines offertes au ciel, ses gradins à demi effondrés qui dessinent un hémicycle d’avant le monde. Je m’approche de la balustrade de la terrasse et je vois dans la pénombre les flambeaux plantés de part en part ; nous les allumerons tout à l’heure, avec mon boy, avant que la foule n’entre dans les lieux. Il me semble apercevoir tous ces visages, déjà, tous ces corps. Les voici qui prennent place sur les coussins blancs dont on a recouvert les pierres. Mille cinq cents spectateurs acheminés par cars entiers, livrés à la jungle préparée, noyés dans les lianes qui tissent un cocon en guise de toit, la voûte imaginaire d’un théâtre de plein air. Ici des palmes, là des fromagers séculaires dont les troncs s’alignent comme les lames d’un décor. On n’a jamais vu ça à Monte Inguana. Il m’a fallu tout imaginer. Je suis un vieil homme, maintenant. À la vérité, on se demande sûrement : « Va-t-il vraiment chanter ? À son âge ! » Je serai l’attraction, la curiosité. Ils ne viennent pas tant pour la représentation — j’ai pourtant rassemblé une distribution des plus vaillantes — que pour recueillir les dernières notes du phénomène épuisé.
Les musiciens de l’orchestre ne vont plus tarder. L’estrade les attend, demi-lune de planches au cœur des blocs de pierre. Pourvu qu’il n’y ait pas de vent. Les voici à mes pieds, les voûtes des caveaux de l’Escurial, décor de ma scène capitale. J’ai répété, oh, j’ai tant préparé ce miracle. Mais ne l’ai-je pas préparé depuis quarante ans, depuis mes heures de gloire ? — mes nuits sont pleines des applaudissements d’antan. Les rideaux de tous les théâtres défilent, un à un, devant mes yeux. Ils se superposent à la gaze végétale, à la mer, là-bas — et je distingue nettement, très nettement, même, la lumière des veilleurs de côte. À cette altitude, seules des lanternes peuvent éclairer. L’électricité ne monte que chez moi, Villa Iguana, palais de mes rêves que traversent la chaleur et les brises humides. Retraite douloureuse loin des projecteurs. Loin d’elle.
Les images reviennent — plus fortes, ce soir. Elle est là. Sa présence est palpable. Et pourtant, elle ne m’aime pas. Non, elle ne m’a jamais aimé. J’ai tout quitté à cause d’elle. La douleur a brisé une carrière déjà bien établie. Je suis parti loin du monde, loin de l’Europe, loin de Venise, surtout. Venise. C’est là qu’elle m’a poignardé. Non, elle ne m’a jamais aimé. Monte Iguana fut mon ultime refuge. Je ne sais pas combien de temps a passé, toutes ces journées à contempler la mer, le ciel, la nuit, ma nuit bientôt tombée lorsque les flambeaux seront consumés. Mais ce soir, l’heure viendra, l’heure du paquebot, l’heure de ma joie renouvelée. Oh, je sais bien que je suis confus. Je suis un vieil homme, maintenant.
Après m’avoir abandonné, elle m’a hanté. J’ai dû me reconstruire, moi le jeune chien fou, moi qui lui avait confectionné un beau mensonge pour croire à ma rédemption.
Je m’étais inventé une carrière de ténor quand je n’étais qu’un vagabond ? J’allais vraiment devenir chanteur. La boisson me tenait quand la raison m’eût sauvé ? J’allais m’atteler sans tarder à ma tempérance. Venise m’aspirait dans les rets de ses sortilèges ? C’est en Amérique du Sud que j’irais trouver d’autres émois, d’autres escarpements pour me lancer un véritable défi — le défi de mon rétablissement moral. Je jouerais mon Fitzcarraldo.
Comme le chemin fut long ! Et elle, elle, toujours là, entêtante ; je la revois encore, regardant en silence mes cheveux blonds, le jour que j’entrais dans sa danse. Le temps n’y faisait rien. Le dehors attisait ma souffrance.
Ces dernières années pourraient se résumer à deux journaux. Deux nouvelles qui m’ont terrassé. La première, celle de sa mort — sa photo magnifique plaquée sur une nécrologie imprécise —, sept ans après mon arrivée ici. Le visage fermé de mon boy ressurgit dans ma mémoire ; son petit air catastrophé, le journal à la main. Car il savait : je lui avais tout raconté (à qui d’autre pouvais-je me confier ?) : Venise, la Fenice, l’Excelsior, nos nuits, notre différence d’âge, sa silhouette de jeune femme malgré ses soixante-dix ans et ses jambes, mon Dieu, ses jambes ! La comtesse di Posa Alba. C’était la légende inscrite sous la cruelle photo. Photo cruelle, heure cruelle, souvenirs cruels.
Le vent s’est levé. C’est une brise, plutôt, qui va retomber. À présent, la villa est plongée dans une obscurité presque totale. Il va falloir allumer. Dans trois heures, l’invisible rideau va se lever, il sera l’heure, l’heure de mon grand air. L’air de Philippe. Philippe II, roi d’Espagne ! Je le chanterai pour moi, pour eux, bien sûr, mais surtout pour elle ! Elle que je ne peux oublier, elle dont le double en pleine jeunesse longera la côte, ce soir, quelque part entre la pointe d’Orabazza et le Capo Rosso. Là encore, il y a deux mois, c’est par le journal que j’ai appris. Elisabeth di Posa Alba, la petite-fille de la comtesse, entame sa tournée internationale. L’Amérique du Sud sera sa première destination. Elle se produira notamment lors d’une croisière reliant Montevideo à Valparaiso. La photo d’Elisabeth m’a fait l’effet d’une douce explosion. Ce n’était pas la jeune cantatrice qui m’apparaissait, c’était la comtesse elle-même. Sublime reflet. Oh, combien cette nouvelle m’a torturé, ce visage revenu d’entre les morts. Amer retour de l’Histoire, et l’ironie de son talent : cantatrice, sa petite-fille, était-ce bien possible ? Mon cœur s’était recroquevillé, une crise, une crise, j’allais m’effondrer. O don fatale ! Je suis un vieil homme, maintenant ; j’attends l’aube dernière.
J’ai guetté les dates. J’ai calculé l’heure de passage du paquebot. J’ai fait appeler la compagnie maritime pour m’assurer de sa présence à bord. Hier encore, je me suis assuré que le bateau avait quitté sa dernière escale. Et puis, je lui ai fait porter ce message mystérieux :
Rendez-vous sur le pont-promenade à vingt-deux heures dix-sept, du côté de la montagne.
On m’a affirmé qu’elle l’avait reçu. Vingt-deux heures dix-sept. Je répète mon grand air.
« Elle ne m’aime pas ! Non ! Son cœur m’est fermé. Elle ne m’a jamais aimé ! »
C’est sur le pont qu’elle entendra la vérité, la vérité vieille de Venise, elle entendra le fait de sa grand-mère, et je lui écrirai après, je lui raconterai ce qu’il s’est passé ; mais ce soir, je chanterai pour l’une, et pour l’autre. Je chanterai pour elles deux.
Ce que le public ne sait pas, c’est que j’ai fait installer des haut-parleurs partout dans la montagne, depuis l’amphithéâtre jusqu’à la plage. Membranes tournées vers la mer, vers la nuit du paquebot lourd et lent qui passera entre la pointe d’Orabazza et le Capo Rosso, tout à l’heure, à vingt-deux heures dix-sept. Elisabeth entendra chanter Monte Iguana. Elle entendra chanter ma tristesse et mon amour intacts.
Où suis-je ? Au loin, la lampe des veilleurs vacille. Il y a du vent, maintenant. Je suis inquiet. Dans la forêt, des flambeaux s’allument qui jettent contre la pierre des flaques rousses. Les spectateurs vont bientôt venir. Ils vont bientôt envahir cette forêt, écouter, admirer, applaudir, m’écouter, m’admirer, oui, m’applaudir dans l’humidité et la chaleur de la jungle. Tout est prêt. À cette heure, le paquebot doit longer les villages scintillants de la Costa Verde ; bientôt elle sera là, elle m’entendra depuis le pont-promenade. Sa petite-fille. Elisabeth !
Je vais m’habiller. Mon costume est suspendu dans l’armoire de cette grande chambre où j’ai tant dormi, tant attendu l’heure absolue. Oui, il me faut m’enfouir, à présent, dans mon manteau royal. Ils vont venir, je dois leur faire honneur.
Au mur, il y a ce grand miroir qui reflète mon visage. Je suis bien maquillé quand, pourtant, je vais offrir ma voix sans fard. Est-ce bien déjà maintenant ? Si vite ?
… Que se passe-t-il ? Quel est ce bruit ? Des oiseaux effrayés ? Des animaux cachés dans la plus obscure jungle ? Ça perce et fracasse quelque part, c’est liquide. Il pleut !... Est-ce possible ? Les grands voilages blancs se soulèvent et s’emmêlent. Il pleut ! Le vent ! C’est le vent ! Pitié, pitié ! Ah ! L’horizon se brouille, les palmes ploient, c’est une tempête, oui, c’est une tempête qui monte. Catastrophe… La mer a reculé, engloutie dans les trombes, le chaos tropical — et les veilleurs ont disparu : plus de lumière, plus de flammes, plus de flambeaux. Tout s’enroule et s’élève dans la nuit qui emporte les coussins blancs ; les stèles sont noyées d’eau, Elisabeth, Elisabeth — et le paquebot ? Venise rampe jusqu’à moi dans la forêt froissée. Venise et son dernier baiser. Non, elle ne m’aime pas, elle ne m’a jamais aimé !
La fête est gâchée. L’heure
fatale a sonné. Me voici. J’avance seul sur la terrasse dans ma nuit ravagée.
Stéphane Héaume